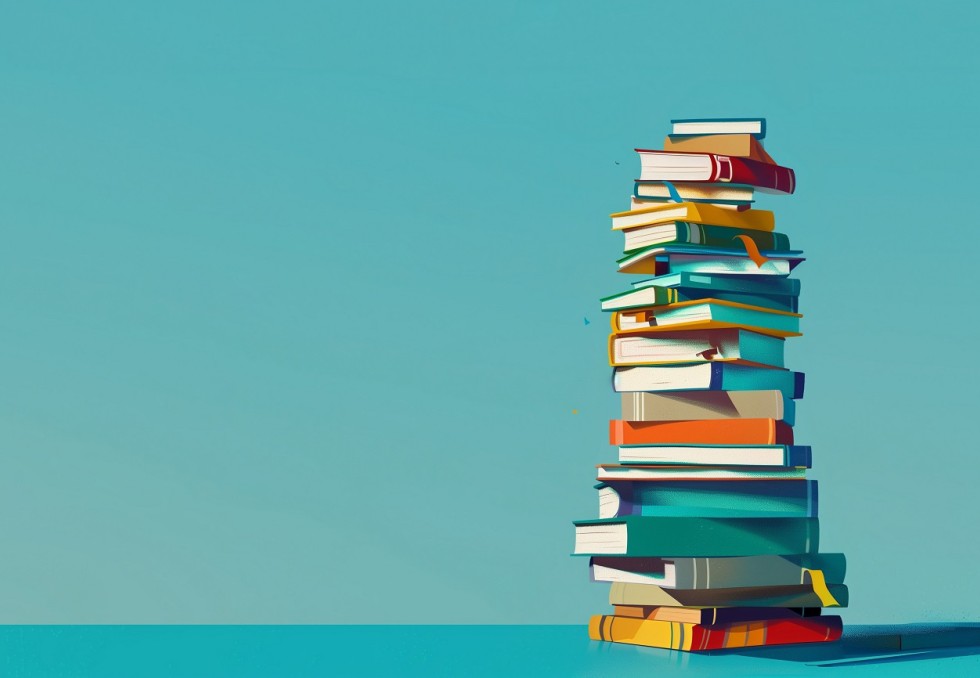
"Les réformes qui s'accumulent malmènent nos étudiants" : comment la nouvelle cheffe de file des doyens veut "stabiliser" les études de médecine
Première femme doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, la Pre Isabelle Laffont est également devenue, mardi 4 mars, la première femme élue à la tête de la Conférence des doyennes et des doyens de médecine. Egalité femmes-hommes, refonte de l'entrée dans les études de santé, simplification des Ecos, mise en œuvre de la quatrième année de médecine générale… La nouvelle cheffe de file des doyens revient pour Egora sur les priorités de son mandat.
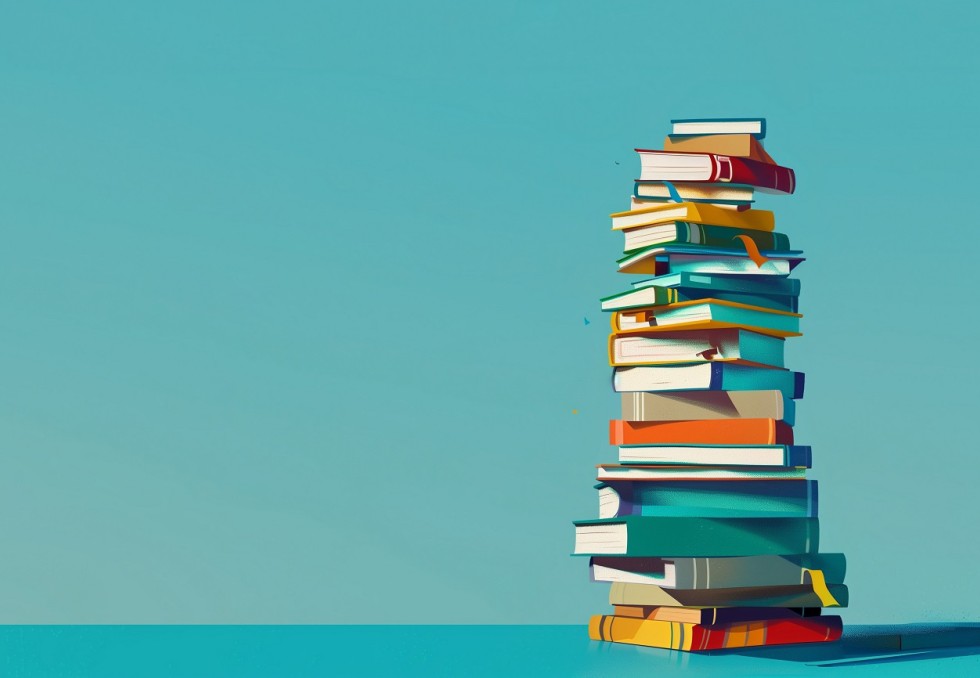
Egora : Le 4 mars, vous avez été élue à la tête de la Conférence des doyens de médecine et êtes devenue la première femme à occuper ce poste. Il y a quelques mois, l'institution a d'ailleurs féminisé son nom en devenant la Conférence des doyennes et des doyens de médecine. Que disent ces changements ?
Pre Isabelle Laffont : La féminisation de la Conférence était une nécessité, mais elle était aussi très largement en route. Jusqu'à il y a trois mois, on était, je crois, sept doyennes parmi les trente-six facultés de médecine ou de santé. Le chiffre est en train de monter. Et puis, au niveau de la présidence et de la vice-présidence de la Conférence, il y avait déjà eu une vice-présidente qui était la Pre Bach-Nga Pham [élue en 2020, NDLR]. Et désormais, je suis la première présidente ; ça veut dire que les choses évoluent.
Cela montre la place de plus en plus importante des femmes dans le milieu universitaire et médical…
C'est un bon signal. Cela montre, à la fois, que la place des femmes est importante, mais c'est aussi que le sujet de l'égalité femmes-hommes, et donc l'accession des femmes à des postes à responsabilités, est en train de devenir une réalité. Et ça, c'est très bien, car dans le monde de la santé, c'est quand même divers. Au niveau par exemple des hospitalo-universitaires, les femmes ne représentent que 25% des PUPH. On est donc encore loin du compte.
Au niveau des présidents de CME de CHU, 16% sont des femmes, et au niveau des directions générales de CHU, c'est 11%. On est quand même dans ce monde encore très loin de l'égalité femmes-hommes, en tout cas sur les postes à responsabilités. C'est donc une bonne chose que la Conférence des doyens évolue.
"Les Ecos sont les épreuves les plus complexes et nécessitent une simplification"
Quelles seront les priorités de votre mandat ?
Il y a six priorités. La première est de renforcer le modèle hospitalo-universitaire et surtout, de promouvoir l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. En effet, les hospitalo-universitaires sont très importants dans la dynamique qui a permis à la médecine française, à travers les actions de soins, d'enseignement et de recherche, d'être ce qu'elle est actuellement, mais on a un petit souci d'attractivité des carrières. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire de façon rapide, en particulier, il faut revoir le statut des chefs de clinique assistants. Il faut améliorer - parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites durant la mandature précédente - le statut des PU-PH et des MCU-PH. Ces sujets-là, il faut continuer à les porter parce que si on n'a plus d'hospitalo-universitaires, le système sera fragilisé.
La deuxième priorité est de conforter la place des facultés de médecine et de santé dans la recherche et dans l'innovation. La troisième porte sur les enjeux pédagogiques ; il y en a deux ou trois. Les deux principaux sont la réforme de l'entrée en études de santé et la réforme du deuxième cycle des études de médecine. Il y en a d'autres aussi, mais ces deux-là sont les plus urgents.
Ensuite, la quatrième priorité est le sujet de la territorialisation et donc de la responsabilité territoriale des facs. C'est un sujet majeur et structurant qui est vraiment un sujet sociétal important. Enfin, la cinquième priorité concerne l'universitarisation des formations paramédicales, et la sixième les étudiants, qui sont un sujet majeur.

Concernant la réforme du deuxième cycle (R2C), elle poursuit sa mise en place cette année. L'an dernier, l'organisation des examens cliniques objectifs et structurés (Ecos) avait pu poser question, avec notamment la menace d'une grève des examinateurs. Comment ces épreuves, prévues fin mai, se profilent-elles cette année ? Serez-vous prêts ?
La réforme du deuxième cycle des études de médecine est une belle réforme. J'ai été présidente du comité de suivi de la R2C [de la Conférence] pendant deux ans. Grâce à cette réforme, on forme et on évalue désormais les étudiants en médecine sur des compétences. C'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, on les évaluait essentiellement sur des connaissances avec beaucoup de QCM. Ce changement de paradigme est vraiment une bonne évolution pour la formation des médecins.
Les Ecos, on les a montés de façon rapide. On a réussi à monter cette réforme, mais il va être nécessaire de la simplifier. Elle est actuellement très complexe, en termes d'organisation notamment. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait pouvoir simplifier dans les deux ou trois ans qui viennent pour la rendre soutenable à moyen et à long terme.
Les Ecos sont les épreuves les plus complexes et nécessitent une simplification. Elles sont extrêmement lourdes à organiser et très fragiles. Car, s'il y a une faculté qui a un incident [durant le déroulé de ces épreuves orales, qui ont lieu en même temps partout en France], cela peut mettre en difficulté l'ensemble de la cohorte d'étudiants.
Pour 2025, on sera prêts. Il y a toujours un risque que ça se passe pas bien, mais on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Pour autant, il faudra les simplifier à partir de l'année prochaine. Cette année, on était un peu bloqués par l'obligation, pour faire évoluer l'organisation des Ecos, de modifier des textes réglementaires, ce qui prend beaucoup de temps. Puis, on a aussi besoin d'analyser ce qui s'est passé l'année dernière sur des données précises pour savoir ce que l'on va simplifier pour rendre cette organisation moins complexe.
Avez-vous de premières pistes de simplification ?
On veut rendre l'organisation plus fluide. Par exemple, on a actuellement pour chaque station [mise en situation passée par les étudiants] deux examinateurs ; l'un qui vient de la faculté où se déroulent les épreuves et un autre issu d'une autre faculté. C'est lourd à organiser, car on déplace beaucoup de monde au même moment. On peut se poser la question de l'intérêt de faire cela, et pour savoir si c'est intéressant ou pas, il faut qu'on analyse ce qui s'est passé en 2024 puis en 2025, et qu'on regarde si ça a un intérêt de maintenir cette complexité.
Il y a aussi des questions qui se posent sur notre capacité à maintenir ces épreuves, avec des Ecos qui soient classants parce que c'est vraiment intéressant qu'ils le soient, en allégeant un tout petit peu les contraintes, en particulier celles qui imposent que tous les étudiants passent les mêmes stations au même moment. On a des pistes pour imaginer que ce soit possible. Pour autant, il faut qu'on montre [l'intérêt ou non de ces pistes] et qu'on puisse l'affirmer avant de le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire cette année.
L'entrée dans les études de santé est une autre de vos priorités. En septembre, la Conférence a reconnu la complexité du système actuel et la nécessité de le simplifier. Elle a notamment proposé que les facultés ne puissent désormais ouvrir qu'une seule voie d'accès aux filières santé, en choisissant soit un système "tout LAS" soit "tout Pass". Cette option est-elle toujours sur la table ?
La Conférence des doyens a évoqué cinq ou six principes. Elle est d'accord pour dire qu'il faut simplifier [le système actuel] et le rendre lisible parce qu'actuellement, les étudiants, les familles et même les professionnels, ont du mal à comprendre cette complexité avec cette double voie d'entrée, ces systèmes qui sont un peu divers...
On pense qu'il faut effectivement aller vers un modèle d'"entrée unique", et qu'il faut abandonner les mots "Pass" et "LAS". Il faut imaginer les choses comme une évolution de l'existant, mais on donnera probablement un autre nom à ce qui devrait sortir des réflexions. L'entrée unique reste donc une hypothèse. Pour autant, elle n'est pas décidée. On travaille à plusieurs là-dessus et avec le ministère.
On aimerait aller vers une évaluation des étudiants sur un corpus commun de connaissances pour qu'en deuxième année ils aient quand même une base de connaissances communes. L'idée est de garder tout ce qui est très bien dans cette réforme, notamment la "marche en avant" des étudiants pour ceux qui feraient deux années pour essayer de rentrer en MMOP [et qui échoueraient], qu'ils n'aient pas perdu leur temps, que derrière ils continuent à avancer dans des études supérieures. On garde l'idée qu'il faut deux chances bien évidemment. Et puis, il y a la question des oraux.
Mais le maître-mot de tout ça, quand même, c'est qu'on pense qu'il ne faut pas tout refaire. On ne va pas refaire une énorme réforme comme on l'a fait en 2019-2020 ; ça serait vraiment déraisonnable. Il faut faire évoluer l'existant vers quelque chose de mieux, et je pense que l'on est capable de le faire.
"Il n'y a pas de raison que les docteurs juniors de médecine générale aient un mode de rémunération différent des internes des autres spécialités"
Certaines évolutions sont-elles actées ? Où en sont les discussions ?
On est dans de vraies discussions concrètes. C'est un sujet qui est très universitaire quand même, et donc il y a des pistes qui sont en train de se dessiner, mais ce ne sont pas des pistes visant à tout refaire. C'est plutôt une évolution du système.
Un autre grand sujet est celui de la quatrième année d'internat de médecine générale. Cette réforme, dont les décrets doivent être publiés au printemps par le Gouvernement, suscite de nombreuses questions, dont celle de la rémunération des docteurs juniors de médecine générale. Certains syndicats plaident pour une rémunération à l'acte de ces internes avec rétrocession, mais la Conférence a récemment rappelé son opposition à cette option…
Pour la Conférence, la quatrième année d'internat de médecine générale est une bonne chose. Qu'on offre à ces internes une quatrième année de formation et qu'on mette la médecine générale au niveau des autres spécialités, c'est normal et c'est bienvenu. D'autant que la conception de cette quatrième année est adaptée. Elle a été très portée par les enseignants.
Après, le sujet de la rémunération à l'acte est peut être aussi une question de la façon dont on exprime les choses, et de comment on la décline. C'est-à-dire que, si "rémunération à l'acte" veut dire que les internes seront payés en fonction du nombre d'actes qu'ils produisent par jour, nous pensons [au sein de la Conférence] que mettre une pression sur les internes liée à l'activité consultation par consultation n'est pas raisonnable. Il peut y avoir d'autres façons de faire à travers une prime à l'activité, à travers un modèle un peu différent…
La décision précise viendra du ministère. Mais nous notre sujet, c'est que cette rémunération ne crée pas d'iniquité entre les différentes catégories d'internes. Il n'y a pas de raison que les docteurs juniors de médecine générale aient un mode de rémunération différent des internes des autres spécialités. Il ne faut pas que ça entraîne un déséquilibre du système avec un mode de rémunération qui serait beaucoup plus attractif que celui des internes dans les hôpitaux, parce que ça risquerait de créer un appel d'air sur une médecine ambulatoire - qu'elle soit de médecine générale ou pas - qui ne serait pas bon.
Là encore, les discussions sont en cours. Nous, ce dont on a peur, c'est que les autres spécialités demandent à avoir le même statut de rémunération à l'acte en ambulatoire pour leurs docteurs juniors, pour éviter que ce soit inéquitable entre les spécialités.
Une autre crainte autour de la quatrième année est le manque potentiel de maîtres de stage universitaires (MSU) pour accueillir les premiers docteurs juniors en novembre 2026. Le Gouvernement a promis d'engager une campagne de recrutement. Etes-vous confiante ? Y aura-t-il assez de MSU pour encadrer ces internes ?
Ce point est indispensable parce qu'une fois de plus, les internes même quand ils sont docteurs juniors restent des internes, qui doivent être encadrés. Il est hors de question d'avoir des internes, surtout en médecine générale dans les territoires un peu éloignés, non encadrés ; donc il faut des MSU.
Je pense que la situation est hétérogène d'une région à l'autre. Dans ma région [dans l'est de l'Occitanie], on n'a pas trop de soucis de recrutement des MSU. Mais il y a des régions où c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'on va arriver à les recruter. En tout cas, c'est indispensable : on ne peut pas lâcher des internes dans la nature.
"Le plus difficile reste de lever l'omerta"
En 2024, une nouvelle enquête menée par des organisations étudiantes a révélé que 26% des internes et 19% des externes ont déjà été victimes de paroles ou attitudes sexistes ou sexuelles déplacées. Vous avez été membre pendant deux ans du groupe sur la prévention des violences sexistes et sexuelles (VSS) et des risques psychosociaux (RPS) au sein de la Conférence. Y a-t-il une véritable prise en compte de ces violences dans les facultés et les hôpitaux ? Comment celle-ci s'observe-t-elle ?
Clairement, on a passé un cap. Maintenant, on en parle, ce sujet est pris à bras-le-corps aussi bien par les institutions universitaires, notamment les facultés, que par celles hospitalières. Au niveau de la Conférence des doyens, on a monté un colloque annuel sur les VSS et les RPS qui a eu lieu trois fois déjà, qui fonctionne bien et dans lequel on traite de ces sujets. On a ouvert des débats qui étaient extrêmement intéressants.
La déclinaison opérationnelle [de cette prise en compte] dépend des sites. Je ne peux pas parler au nom de toutes les facultés de médecine de France. Mais de façon très concrète et très symbolique, quand j'ai été élue doyenne [de la faculté de Montpellier-Nîmes], j'ai nommé une vice-doyenne en charge du bien-être étudiant, de la prévention des RPS et des VSS. On a mis en place des référents VSS pour que les étudiants et les étudiantes aient des personnes à appeler. On a mis en place des mesures pour les accompagner dans des démarches judiciaires, donc des signalements à la police ou à la gendarmerie, ou pour faire des signalements internes en vue d'une enquête administrative, qui peut aller jusqu'à une section disciplinaire pour les agresseurs présumés. Surtout, on a fait ce que font beaucoup de facs, c'est-à-dire de l'information, de la formation et de la prévention. Et puis, on a essayé de lever l'omerta.
Je raconte cela car je le connais, mais ça existe au national dans la majorité des facs avec des déclinaisons un peu différentes. Le plus difficile dans tout ça reste de lever l'omerta. On voit bien que, pour l'instant, on n'a pas complètement libéré la parole et qu'il y a encore beaucoup de retenue, d'hésitation... Il y a des craintes malheureusement, mais petit à petit, ça change quand même.
Enfin, l'Académie nationale de médecine s'est récemment positionnée en faveur d'une réduction de la durée des études de médecine d'un à trois ans. Partagez-vous cet avis ?
J'ai lu attentivement ce rapport de l'Académie, et j'en pense plusieurs choses. La première, c'est que personnellement je ne crois pas qu'on puisse réduire la durée des études de médecine raisonnablement. Ce sont des études qui sont exigeantes et qui sont longues parce qu'il y a malheureusement besoin de temps pour former un médecin. On peut probablement les améliorer, mais on peut pas dire comme cela qu'on va les réduire d'un à trois ans, ce n'est pas raisonnable. D'autant qu'on augmente la longueur des études dans plein d'autres professions, et en particulier celles paramédicales ; ça serait un peu paradoxal.
La deuxième chose est que l'on ne peut pas non plus imaginer, tant que l'on n'a pas fini les réformes des premier et deuxième cycles, remettre de nouvelles réformes profondes et structurelles dans les facultés de médecine. On est sous des trains de réformes depuis une dizaine d'années, il faut stabiliser le système ; c'est urgent. Il faut optimiser ce que l'on fait - et on a de la marge là-dessus - et pas d'emblée complètement tout remouliner et tout changer.
Dans ce rapport, il y a des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut se questionner, mais attention aux réformes supplémentaires. Les réformes qui s'accumulent malmènent quand même un petit peu nos étudiants, et la question de leur bien-être est un sujet majeur dans les facs. Ils ont besoin d'un peu de stabilité, et les facultés, les enseignants et les administratifs également.
La sélection de la rédaction



Faut-il raccourcir les études de médecine?
MICHAEL FINAUD
Oui
Plutôt oui , même si la question est particulièrement mal posée comme souvent dans ces sondages à réponse binaire sur des sujets m... Lire plus