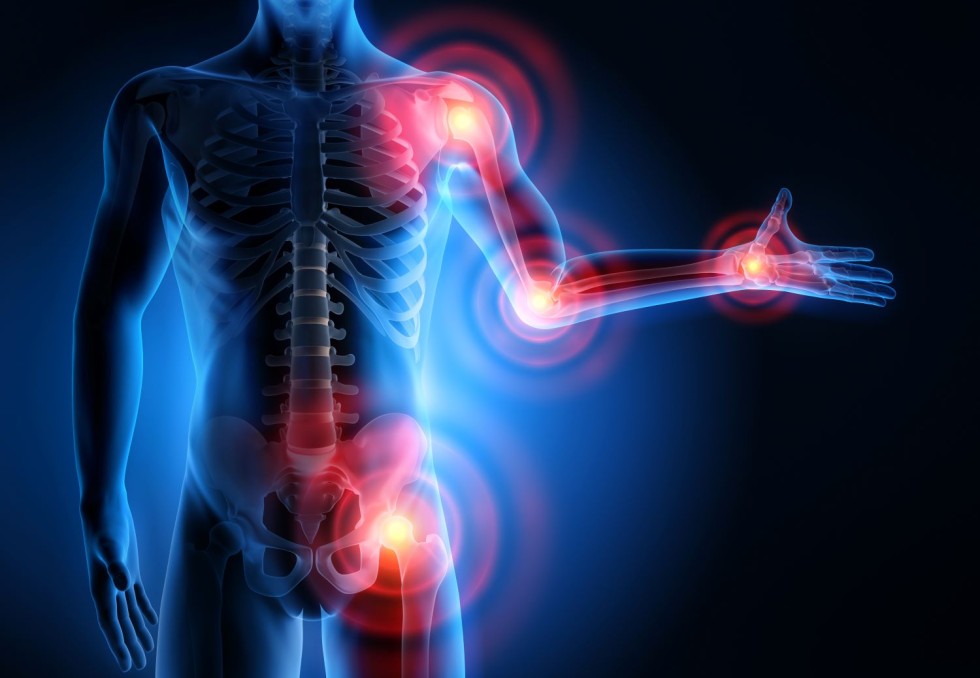
Rhumatismes inflammatoires : l’horizon lointain d’un traitement préventif
Sera-t-il un jour possible de prévenir la survenue de rhumatismes inflammatoires chroniques par la prise d’un traitement précoce ? Si la réflexion est bien avancée pour le rhumatisme psoriasique et dans la polyarthrite rhumatoïde, elle se heurte à plusieurs obstacles pour la spondyloarthrite axiale, en l’absence de marqueur biologique précoce.
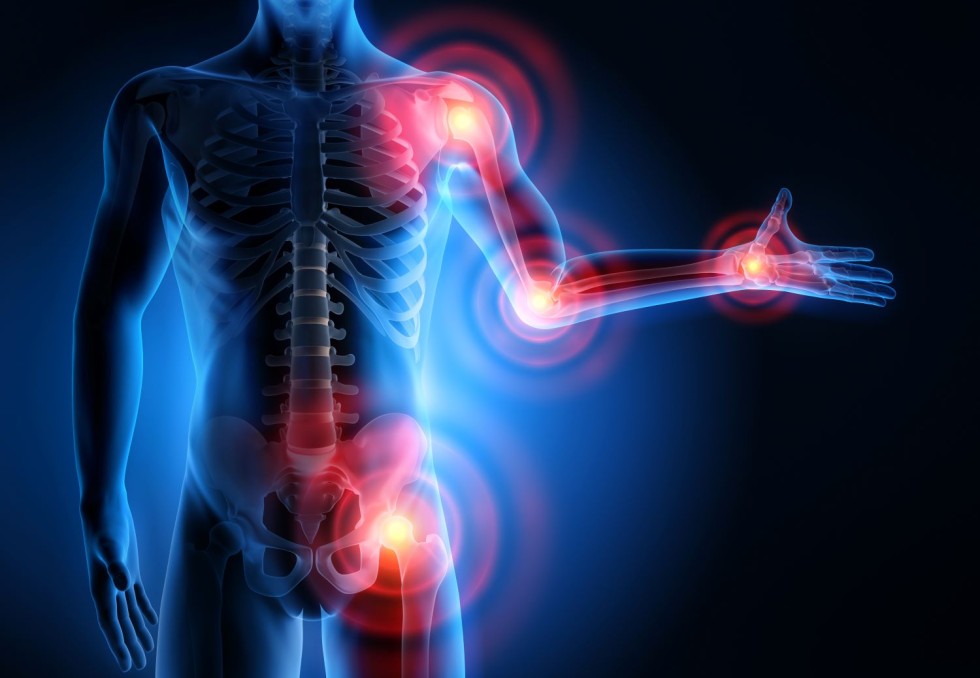
De la même manière que dans d’autres maladies, par exemple le diabète de type 1, «le concept de "prémaladie" se développe dans les rhumatismes inflammatoires chroniques : l’enjeu est d’identifier une phase préclinique de la maladie, en vue d’une intervention thérapeutique qui permettrait d’intercepter la maladie avant qu’elle se déclare», explique le Pr Daniel Wendling, du service de rhumatologie du CHU de Besançon. Plusieurs essais ont été menés à cet effet dans des formes précoces de polyarthrite rhumatoïde, avec des résultats mitigés lors de traitements par abatacept et par rituximab.
«Pour l’instant, les résultats ne sont pas très concluants. Cela semble décaler, plutôt qu’empêcher, l’apparition de la maladie (1). Toutefois, il est bien connu que, lorsqu’on traite une polyarthrite rhumatoïde assez tôt, on obtient une meilleure efficacité et que l’on parvient à mettre plus de gens en rémission», ajoute le rhumatologue bisontin.
C’est dans le rhumatisme psoriasique que le concept de «prémaladie» semble à ce jour le mieux établi (2). Dans 90% des cas, cette maladie se manifeste en premier lieu par un psoriasis cutané, qui survient jusqu’à dix ans auparavant. «Il existe un faisceau d’arguments selon lesquels les patients atteints de psoriasis cutané, lorsqu’ils sont traités par des thérapies ciblées [des biothérapies souvent identiques à celles utilisées contre les rhumatismes inflammatoires chroniques, NDLR], présentent une moindre incidence de rhumatisme psoriasique par rapport à ceux qui n’ont reçu que des traitements topiques ou de la puvathérapie», constate Daniel Wendling.
Une préspondyloarthrite difficile à cerner
En revanche, l’identification d’un stade de «prémaladie», et donc d’une fenêtre d’opportunité préventive, semble bien plus ardue dans la spondyloarthrite ankylosante. «Il existe peu de données dans la littérature qui confortent cette idée de fenêtre d’opportunité. Si on traite tôt les patients avec des anti-TNF alpha, on s’aperçoit qu’ils progressent moins, et ces traitements ciblés présentent de meilleures réponses dans les formes précoces, non radiographiques», explique Daniel Wendling. Mais, au-delà des bénéfices d’un traitement précoce sur la progression de la maladie, il n’existe à ce jour aucune preuve d’un réel effet préventif.
Parmi les difficultés, le fait que le diagnostic de la spondyloarthrite, bien qu’il ait progressé ces dernières décennies, n’est posé souvent que plusieurs années après l’apparition des premiers signes cliniques. En cause, la faible spécificité de ceux-ci, tels qu’une lombalgie. De plus, la maladie est d’évolution lente, ce qui complique l’identification de l’éventuel effet préventif d’un traitement.
«Les patients à risque, sans diagnostic formel de spondyloarthrite axiale, évoluent peu. Dans la cohorte [française] Desir, moins de 1% des patients à risque étaient diagnostiqués avec une spondyloarthrite chaque année (3)», rappelle Daniel Wendling. De même, une analyse menée sur les cohortes Desir et Space (néerlandaise) a révélé que, parmi les patients à risque de spondyloarthrite axiale, 89% l’étaient toujours cinq ans plus tard (4).
HLA-B27, antécédents familiaux, signes extrarhumatologiques
Dès lors, sur quoi se fonder ? «Certainement pas sur les éléments de progression radiographique. Peut-être faut-il recourir à des éléments cliniques, tels que les rachialgies inflammatoires, mais elles sont très fréquentes, donc peu discriminantes. Il faudrait peut-être les associer à d’autres éléments cliniques, mais alors nous ne sommes plus vraiment dans la "prémaladie"», note Daniel Wendling.
De plus, il n’existe à ce jour aucun marqueur biologique identifié d’évolution vers une future spondyloarthrite axiale. Parmi les facteurs les mieux identifiés, l’antécédent d’uvéite, de psoriasis ou de maladie inflammatoire chronique de l’intestin ou encore la présence de l’allèle HLA-B27, dont 8 % de la population est porteuse. «Mais c’est un élément relativement restrictif : seules 5% des personnes positifs à HLA-B27 développeront une spondyloarthrite au cours de leur vie (5)», tempère Daniel Wendling.
Population probablement la plus à risque, celle des personnes apparentées au premier degré avec un patient atteint de spondyloarthrite et de plus porteuses de l’allèle HLA-B27. Lors d’une étude néerlandaise, l’incidence de spondyloarthrite axiale y atteignait 26% sur un suivi de trente-cinq ans (6). Toutefois, il semble illusoire de traiter l’ensemble des personnes apparentées dans l’espoir d’éviter une maladie, somme toute rare et d’évolution lente, dont la survenue est loin d’être assurée, même en cas de risque accru. Selon Daniel Wendling, «rien ne permet pour l’instant de définir ce qu’est un tableau de préspondyloarthrite. Le chemin est encore long, et nécessitera des études qui ne peuvent être menées que de manière collective, à l’échelle nationale ou internationale».
Au programme du congrès :
- CAR-T cells : une révolution en gestation
- Arthrose de la main : de premières recommandations françaises
- Gonarthrose : une recherche sur plusieurs fronts
- Les nombreux bénéfices de la supplémentation vitamino-calcique
- Rhumatismes inflammatoires chroniques : la pollution de l’air favoriserait les poussées
Références :
D’après le 37e Congrès français de rhumatologie, Paris, 8 au 10 décembre 2024. D’après la présentation du Pr Daniel Wendling (CHU de Besançon) lors de la session « La pré-spondyloarthrite axiale, questions et enjeux ».
1. Van der Helm-van Mil AHM. Joint Bone Spine, 15 février 2023.
2. López-Medina C, et al. Rheumatology (Oxford), 1er janvier 2025.
3. Molto A, et al. Annals of the Rheumatic Diseases, 12 juin 2024.
4. Sepriano A, et al. Annals of the Rheumatic Diseases, 24 janvier 2020.
5. Hwang MC, et al., Clinical Rheumatology, 22 mars 2021.
6. Van der Linden SM, et al., Annals of the Rheumatic Diseases, 11 mars 2022.
La sélection de la rédaction



Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?
Blue GYN
Oui
Tout dépend comment on pose la question. - Tout travail mérite salaire et il faut arrêter de râler sur tout et en permanence, (Arr... Lire plus