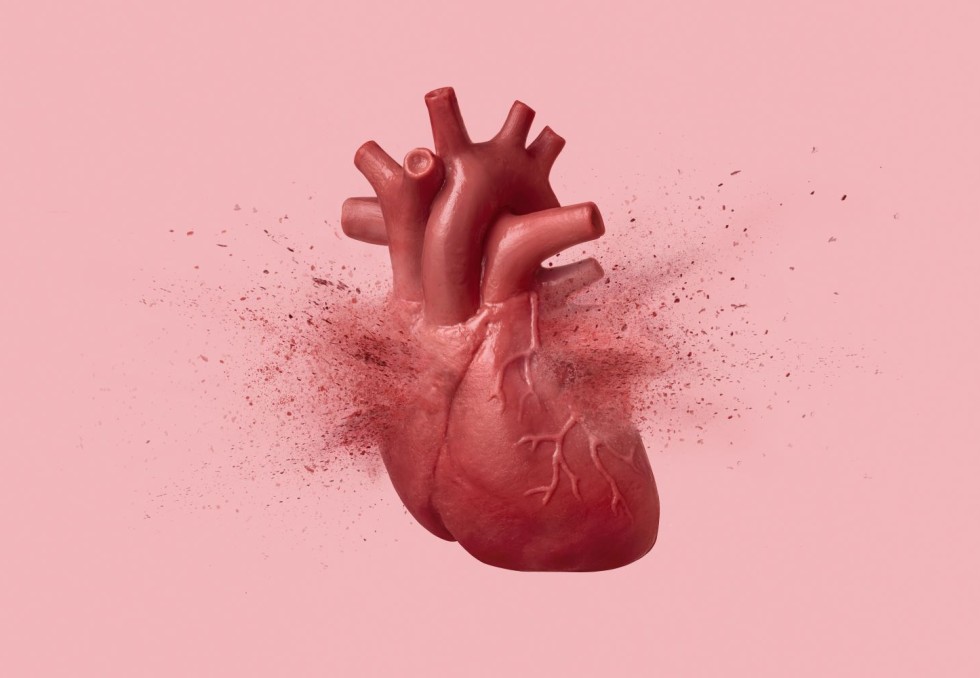
Post-infarctus : renforcer le suivi du patient
Si de nouvelles classes thérapeutiques ont émergé pour la prise en charge du patient après un infarctus du myocarde, l’observance reste très insatisfaisante. Le suivi de long terme, par le médecin généraliste en lien avec le cardiologue, doit être renforcé.
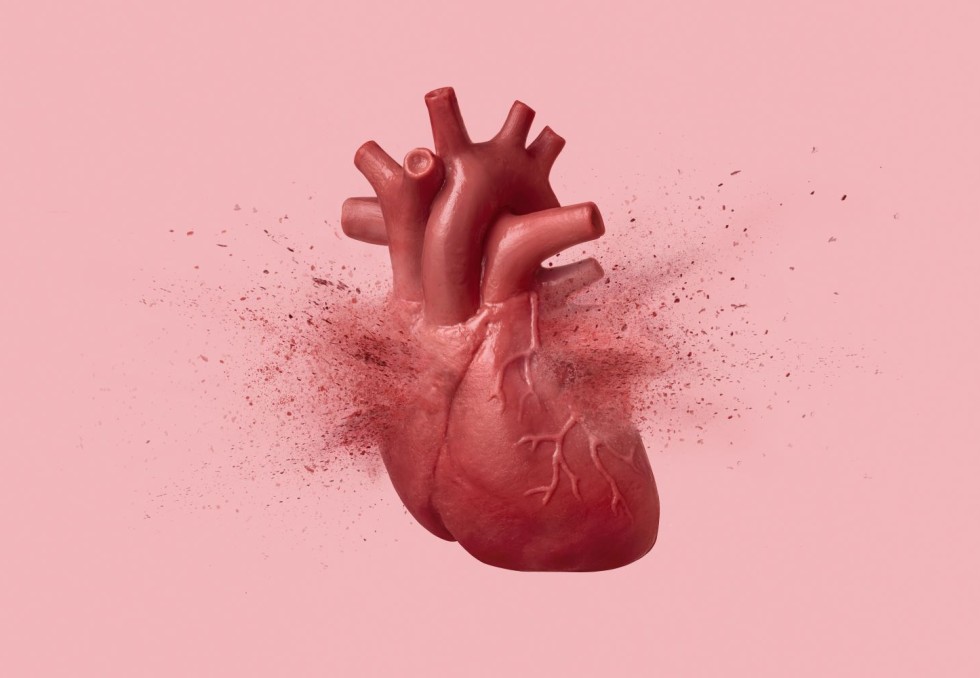
Quelque 100 000 personnes sont victimes d’infarctus du myocarde (IDM) chaque année en France, avec un taux de survie à un an passé à 89 %. «Les taux de mortalité arythmique et non arythmique à trente jours ont diminué sur les vingt dernières années, en lien avec les progrès dans le traitement de la phase aiguë (revascularisation) et de la phase chronique (resynchronisation cardiaque, traitement pharmacologique) et dans la prévention secondaire», a salué le Dr Steve Huijnen, cardiologue à l’hôpital Kirchberg au Luxembourg.
La prise en charge nécessite un suivi rapproché dans l’année suivant l’infarctus, avec une consultation par mois chez le médecin généraliste et une consultation trimestrielle chez le cardiologique. L’un des objectifs est de réévaluer le risque arythmique, évolutif au fil du temps. "La prédiction actuelle, fondée seulement sur la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) et l’étude électrophysiologique, est imparfaite. Les modèles de prédiction basés sur l’intelligence artificielle devraient permettre une personnalisation du risque", a annoncé le Dr Huijnen. Mais le chemin est encore long pour un usage en routine, faute de validation des techniques : biais des données servant à nourrir les algorithmes, incapacité à justifier les décisions («boîte noire»)…
Une observance à améliorer
Dans l’attente de nouveaux outils, les consultations régulières doivent permettre au médecin de s’assurer de la bonne observance des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses… Aujourd’hui, très en-deçà des objectifs. L’étude InterAspire, menée dans 14 pays sur la période 2020-2023 auprès de plus de 4 500 patients admis à l’hôpital pour infarctus, montre que seul 1% d’entre eux respectaient de façon optimale les mesures de prévention secondaire.
De fait, dans l’année suivant l’événement cardiaque, 48% des sujets continuaient à fumer, 41% présentaient une obésité abdominale, autant n’atteignaient pas les objectifs d’activité physique, 83% avaient un taux élevé de cholestérol LDL (≥ 4 mmol/l), 61% une pression sanguine élevée (≥ 130/80 mmHg) et 91% n’avaient pas participé à la réhabilitation cardiaque.
Accompagnement numérique
Aussi, les guidelines 2024 de la Société européenne de cardiologie (ESC) proposent des outils pour améliorer l’adhésion, fondés notamment sur l’usage du numérique (SMS, applications mobiles, dispositifs médicaux portatifs...), les interventions comportementales, la simplification du traitement médicamenteux (combinaison de molécules), l’éducation thérapeutique et l’implication du patient. Ces recommandations incluent «les Prom [Patient-reported outcome measures] et le feedback patient, c’est une nouveauté», a commenté le Dr Bruno Pereira, cardiologue interventionnel à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. Elles visent à «améliorer la littératie en santé et l’empowerment du patient dans une logique de décision partagée. Le soignant doit prendre le temps de dispenser un discours adapté et améliorer la perception du risque cardiovasculaire et les bénéfices du traitement».
Nouvelles options médicamenteuses
Le traitement médicamenteux peut comprendre une bithérapie antiagrégante, des bêtabloquants, des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, des inhibiteurs des minéralocorticoïdes, des SGLT2-i et, le cas échéant, des diurétiques de l’anse.
Chez les patients multitronculaires, «le clopidogrel a la même efficacité que l’aspirine après une intervention coronarienne percutanée mais cause moins d’événements hémorragiques. Sur le critère composite (mort cardiovasculaire, infarctus du myocarde ou AVC), il est supérieur, avec 5,5% d’événements contre 6,3%. L’aspirine 75-100 mg au quotidien reste recommandée tout au long de la vie en cas de pontage, a détaillé le Dr Pereira. Les SGLT2i ont prouvé un bénéfice cardiovasculaire» et sont recommandés chez les patients avec diabète de type 2 et syndrome coronarien chronique.
Le sémaglutide, agoniste du récepteur du GLP-1, «devrait être considéré chez les patients avec syndrome coronarien chronique, sans diabète mais avec surpoids ou obésité», a poursuivi le Dr Pereira. «La diminution du cholestérol entraîne une diminution du taux d’événements cardiaques indésirables majeurs», a souligné le Dr Christophe Tron, cardiologue au CHU de Rouen. «Il faut traiter rapidement et fort, plutôt que de procéder à une escalade thérapeutique.»
Les autres articles de ces Journées européennes :
- La France se dote d’une vaste cohorte sur l’infarctus du myocarde
- Endocardite infectieuse : l’alcool comme principal facteur de risque ?
- Insuffisance cardiaque : de nouvelles connaissances grâce à l’IA
- Insuffisance cardiaque : le passage hôpital-ville, un moment crucial
- Rétrécissement aortique : le Tavi supérieur à la chirurgie chez la femme
- Maladies cardiovasculaires : le médecin généraliste au cœur du parcours patient
Références :
D’après les présentations des Drs Steve Huijnen (Luxembourg), Bruno Pereira (Luxembourg) et Christophe Tron (CHU de Rouen) lors de la session « Le patient à distance de l’infarctus du myocarde », aux Journées européennes de la Société française de cardiologie (JESFC, Paris, du 15 au 17 janvier 2025)
La sélection de la rédaction
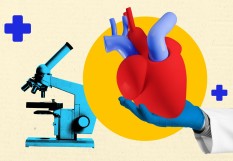


Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?
Jean Denis MARZIN
Non
L'Ordre des Médecins pourrait piocher dans ses réserves et son patrimoine qui sont de 262 millions d'euro..., Voici un extrait de... Lire plus