
Supprimer les ARS ? La proposition d’une commission d’enquête du Sénat
Un rapport sur les agences de l’Etat, publié jeudi 3 juillet, soumet 60 recommandations pour améliorer la “lisibilité de l’action publique”... et réduire un peu la dépense. Parmi celles-ci : le transfert des attributions des agences régionales de santé (ARS) aux services régionaux et départementaux, sous l'autorité des préfets.

Parmi les recommandations les plus marquantes formulées dans le rapport issu de la commission d’enquête, il y a la numéro 38, qui concerne spécifiquement la santé : le transfert des attributions des ARS aux services déconcentrés de l’Etat - aux niveaux régional et départemental -, sous l’autorité des préfets. Il s’agirait, par là, écrit la commission, de “clarifier l’organisation de la politique de santé dans les territoires”. Pour justifier cette proposition, elle explique avoir constaté, “au cours de ses auditions comme de ses déplacements, les nombreuses critiques dont font l’objet” les ARS : “lenteur bureaucratique et inefficacité des procédures”, “éloignement des réalités locales et déficit de concertation”, “poids financier et recherche d’économies”.
Pour illustrer son propos, elle reprend plusieurs verbatims, comme, celui, par exemple, d’Isabelle Dugelet, représentante de l’Association des maires ruraux de France (ARMF), qui regrette un “manque de proximité entre les ARS et les élus, ainsi qu’une connaissance insuffisante des réalités locales”. La commission d’enquête considère que si “la formule de l’agence a pu être nécessaire au moment de leur création en 2010, pour permettre la mise en commun de personnels et de ressources d’origines diverses”, cette réforme, “utile en soi, a présenté l’inconvénient de constituer des acteurs perçus comme manquant de légitimité, car trop éloignés du niveau départemental indispensable pour la proximité opérationnelle”.
Pour la commission d’enquête, une telle réforme permettrait déjà une “clarification des circuits administratifs, pour une meilleure responsabilisation des acteurs”. Elle supprimerait “les ambiguïtés (...) dans la répartition des responsabilités entre le préfet et l’ARS et permettrait d’exercer chaque branche de la politique de santé au niveau territorial le plus approprié". Elle détaille :
au niveau régional, une direction régionale de la santé (DRS), rattachée à la préfecture de région - et à laquelle le personnel du siège de l’ARS serait affectée -, “reprendrait les fonctions de pilotage stratégique aujourd’hui dévolues à l’ARS” (ex : élaboration du projet régional de santé, coordination en cas de crise sanitaire régionale, etc.). Le préfet de région, lui, “présiderait les instances de coordination sanitaire à l’échelle régionale”.
au niveau départemental : les délégations départementales des ARS “seraient placées sous l’autorité du préfet de département pour exercer les missions de proximité” (suivi des établissements de santé et médico-sociaux, animation des contrats locaux de santé, etc.).
Elle permettrait aussi “une rationalisation des circuits budgétaires, sources d’économies” : “la subvention pour charges de service public serait réintégrée dans les crédits du ministère et les contributions de l’Assurance maladie pourraient transiter via un fonds national fléché vers les préfectures”. Le rapport indique que “plusieurs sources d’économies sont attendues”, via la rationalisation des fonctions support, la réduction des postes de direction, une meilleure allocation des ressources aux soins.
Une telle réforme, avec un passage sous l’autorité des préfets pourrait enfin permettre selon, le rapport, de simplifier et fluidifier les relations entre l’administration sanitaire et les acteurs locaux - collectivités territoriales, professionnels de santé de terrain, usagers. Ainsi, confier les missions de santé aux préfets, qui “sont déjà les interlocuteurs naturels des maires et des présidents de conseils départementaux ou régionaux”, créerait “un guichet unique local de l’Etat pour les élus”. Le propos est illustré : “Un maire confronté à la fermeture d’un service d’urgence ou à la désertification médicale (...) pourrait saisir directement le préfet de département, avec qui il travaille au quotidien, ce qui faciliterait la remontée des problèmes et la co-construction de solutions” ; “sous l’égide des préfets, en cas de dossier urgent (ex : autorisation d’un nouvel équipement médical, recrutement d’un praticien à l’étranger (...), la décision préfectorale pourrait être prise plus vite, en lien avec le ministère si un arbitrage est nécessaire”.
Au mieux, 540 millions d’euros d’économies ?
Supprimer les agences de l’Etat pour faire des économies ? C’est le mantra de nombreux politiques, pour qui elles symbolisent la gabegie de l’argent public. Le Premier ministre, François Bayrou, s’interrogeait ainsi en janvier : “Est-il nécessaire que plus de 1 000 agences, organes ou opérateurs, exercent l’action publique ?” et ce “sans contrôle démocratique réel”. Le même mois, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains (LR) en Île-de-France, avait elle pris pour cible l’Ademe. En avril, c’est la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui estimait à entre 2 et 3 milliards les économies réalisables en s’y attaquant…Pendant 5 mois, une commission d’enquête sénatoriale s’est penchée sur les 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs et 1153 organismes publics nationaux. Ses conclusions, rendues le 3 juillet, ne vont pas tellement dans le sens des politiques… “Au risque de décevoir ceux qui voyaient dans ce travail des milliards d’économies, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. Pas de serpe, pas de hache”, a déclaré le président de la commission, Pierre Barro (Groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste - et Kanaky). Mais les sénateurs estiment que des économies sont envisageables, via une meilleure organisation, la mutualisation de fonctions support…
Par ces seules réorganisations, sur deux ou trois ans, et en adoptant une approche “très volontariste”, ils jugent qu’on pourrait seulement parvenir à 540 millions d’euros d’économies. Soit pas grand chose, comparé aux 40 milliards d’euros d’économies espérés par le Gouvernement pour son budget 2026. “Ces milliards [d’économies] sont possibles”, selon la rapporteuse du texte Christine Lavarde (LR) Mais alors “ce sont des milliards qui seront pris sur les politiques publiques et sur les subventions”. Le rapport, fruit d’un travail transpartisan, pointe bien néanmoins que l’Etat central n’a pas de “vision consolidée” de l’état des finances et des effectifs de ses agences. Que la multiplication des agences déconcentrées nuit à la lisibilité, ce contre quoi ils entendent proposer des solutions (fusions, transferts de missions, suppressions…). Ces conclusions, qui ferment en quelque sorte la porte aux économies sur le dos des agences de l’Etat, n’adviennent pas à n’importe quel moment, le budget 2026 étant en préparation. Invité de BFM jeudi soir, François Bayrou a annoncé que les grandes orientations seront présentées le 15 juillet. [Avec AFP]
La sélection de la rédaction


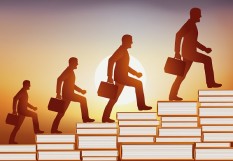
Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?
Jean Denis MARZIN
Non
L'Ordre des Médecins pourrait piocher dans ses réserves et son patrimoine qui sont de 262 millions d'euro..., Voici un extrait de... Lire plus