Cet article a été rédigé par le Pr Jean-Claude Nouët, ancien PU-PH et vice-doyen de La Pitié-Sapêtrière. L'extrait
L’enfant mâle remue plus tôt que l’en fant femelle. Il commence à se mouvoir dès le quarantième jour. Hippocrate enseigne que la femme qui porte un garçon a de belles couleurs et jouit d’une bonne santé, mais elle est pâle et valétudinaire si elle est grosse d’une fille. Il dit aussi que l’on sent l’enfant mâle au côté droit, et la fille au côté gauche.
La femme qui est grosse d’un garçon a le pouls du poignet droit plus élevé, plus fort et plus fréquent que celui du côté opposé ; sa mamelle droite grossit avant la gauche, les bouts de l’une et l’autre regardent en haut ; lorsqu’elle marche, elle part du pied droit et elle fait premièrement agir sa main droite dans toutes les actions ; le contraire arrive si elle porte une fille.
La femme conçoit un garçon si la lune est en croissant, et une fille si elle est en son déclin. L’urine d’une femme grosse est souvent épaisse et trouble : si ce trouble monte en haut, elle est grosse d’un garçon, si elle se précipite, elle accouchera d’une fille.
Mauriceau remarque, avec plus de justesse, qu’une femme qui a eu plusieurs enfants tant mâles que femelles, est en état de juger plus que toute autre si elle porte un garçon, en comparant la santé dont elle jouit avec celle des gros sesses précédentes, car il est constant que le tempérament change selon le sexe de l’enfant que l’on contient dans ses entrailles.
Ce n’est pas assez de deviner si la femme porte un mâle ou une femelle : certains enseignent l’art de faire des garçons. Nous répétons que nous n’ajoutons aucune foi à ces recettes, et ce n’est que pour satisfaire la curiosité des Dames que nous les rapportons.
Pour faire un mâle, il ne faut être ni trop jeune ni trop âgée ; il faut se nourrir de viandes succulentes et pleines d’es prit : pigeon, lièvre sont propres à cette fin. Les aliments froids et aqueux nedonnent un sang que pour engendrer des filles. Si l’on fait des excès dans le boire et le manger, si l’on use des droits du mariage plus de trois ou quatre fois le mois, on n’est point apte à faire des garçons. Enfin, l’on conçoit un mâle plutôt en hiver qu’en été. Voilà les règles que des Médecins osent donner. "
Le décryptage Le jeu des devinettes a duré jusqu’à l’arrivée de l’échographie, sur des signes aussi farfelus et tout autant assurés que jadis : lune croissante ou décroissante, pendule qui bat ou qui tourne, peau sèche ou souple, envies de salé ou de sucré, ventre pointu ou arrondi, blanc des yeux jauni ou bleui, etc. Le médecin prudent et...
psychologue annonçait une fille, car l’arrivée d’un garçon faisait oublier l’erreur ! Autrefois, le sujet était très sérieux, car il était important, parfois capital, quel que soit le milieu social, que naisse un garçon, surtout s’il était le premier enfant : il était alors appelé à assurer une succession (voir les enseignes « Père et fils »), à hériter de terres, d’un patrimoine, d’un métier, d’une charge, d’un titre, voire d’un trône. L’incertitude pesait autant sur la mère que sur le père, puisque le sexe de l’enfant était supposé dépendre de la mère, dont le devoir était de donner un héritier mâle. Y faillir pouvait motiver un divorce ou une répudiation.
Cette « obligation » a excité les imaginations, jusqu’à la publication d’ouvrages de charlatans sur les moyens de faire des garçons : en 1655, La Callipédie, de l’abbé Quillet, en latin, traduite en 1746, L’Art de faire des garçons, de Procope-Couteau en 1748, un autre de Bassel en 1755. Ils n’ont eu aucun effet sur le sex-ratio ! La « responsabilité » de la mère a duré jusqu’à la découverte de la fusion des gamètes (Hertwig, 1876), à celle des deux chromosomes sexuels (Nettie Stevens, 1905) et à la théorie chromosomique de l’hérédité (Morgan, et al. 1915). Aujourd’hui, connaître d’avance le sexe ne fait que calmer l’angoisse, bien choisir le prénom et permettre de préparer un trousseau.
La sélection de la rédaction


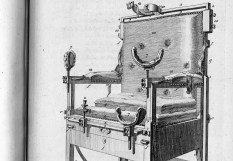
Etes-vous prêt à stocker des vaccins au cabinet?
Fabien BRAY
Non
Je tiens à rappeler aux collègues que logiquement tout produit de santé destiné au public stocké dans un frigo, implique une traça... Lire plus